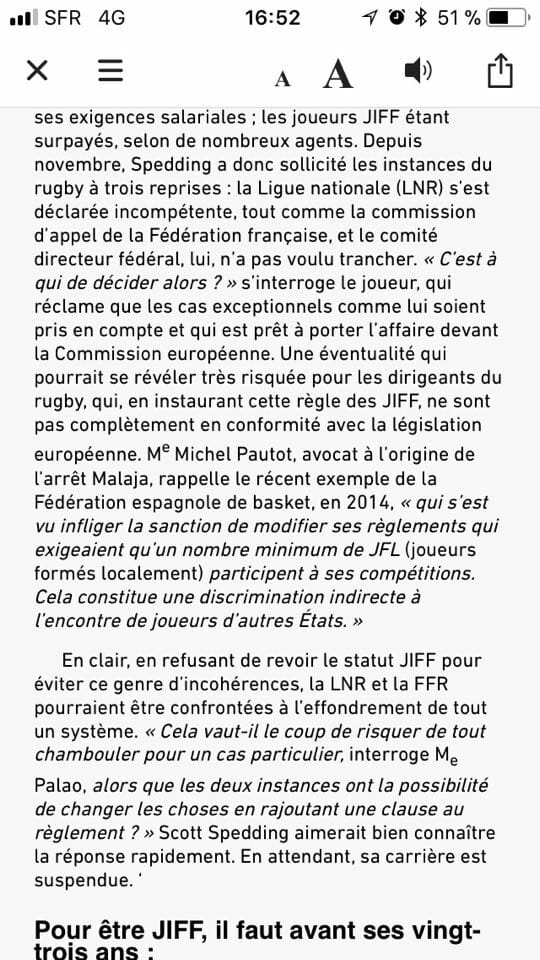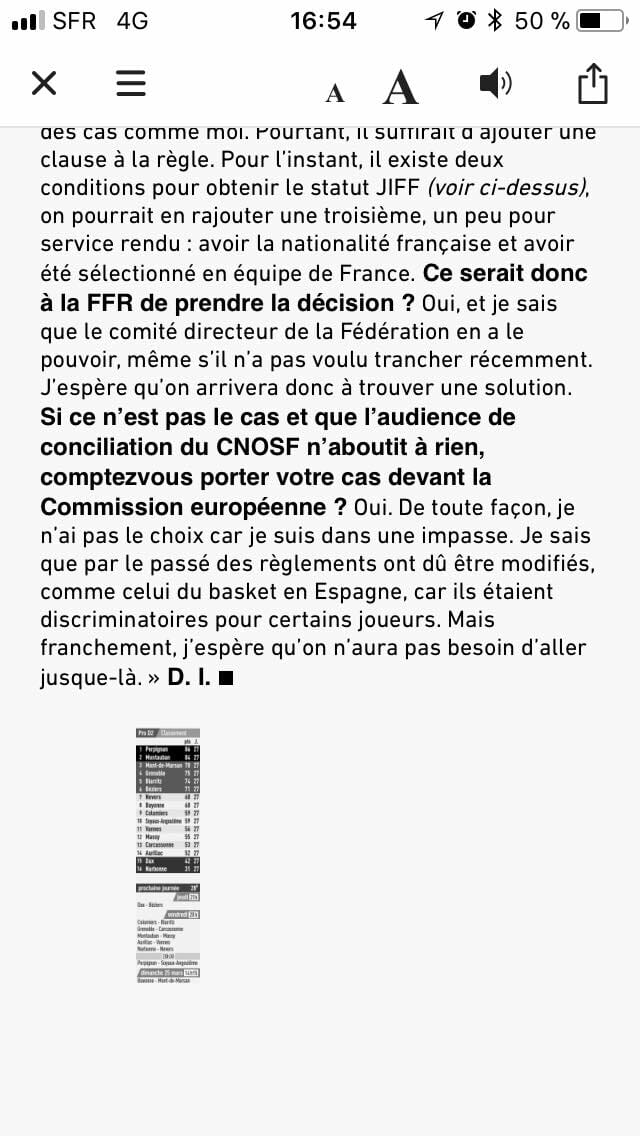Les données personnelles et le droit français
Le Règlement Général sur la Protection des Données est entré en vigueur le 25 mai 2018 (voir précédent article du mois de mai 2018 sur le présent site) : tous les acteurs professionnels ont alors dû se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences en matière de gestion de données personnelles, alors même que le législateur français n’a lui-même promulgué qu’ultérieurement une loi sur le sujet, et que la CNIL continue, plusieurs mois après, de rendre des délibérations pour son application...
Retour sur six mois de textes parus en droit français dans le prolongement de l’entrée en vigueur du Règlement CE RGPD, tant au niveau législatif et exécutif (1) qu’administratif (2).
- Loi 2018-493 et Ordonnance 2018-1125
Sur le fond c’est tout d’abord la Loi 2018–493 du 20 juin 2018 qui a adapté la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 ; ainsi, et à titre d’exemples :
- la réforme faisant passer la France de son ancien système déclaratif à un système désormais de contrôle en aval, les dispositions relatives à l'obligation de déclaration préalable auprès de la CNIL ont essentiellement disparu, à quelques exceptions près (données de santé notamment) ;
- corrélativement les pouvoirs de contrôle de la CNIL sont étendus, notamment pour les opérations en ligne, que les contrôleurs peuvent désormais réaliser sous une identité d'emprunt (art. 5 Loi 2018–493 du 20 juin 2018 / art. 44 Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978).
Sur la forme c’est ensuite l’Ordonnance 2018–1125 du 12 décembre 2018 qui a plus récemment donné un « plan plus lisible, ordonné et cohérent » à la Loi du 6 janvier 1978 (selon les termes du compte rendu du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, même si le nombre d’articles de ladite loi est à cette occasion passé de 72 à 128…) ; ainsi :
- les nouvelles dispositions RGPD ont essentiellement été concentrées aux articles 42 à 86 de la Loi du 6 janvier 1978, concernant notamment le nouveau droit à la portabilité des données (art. 55), le Registre des activités de traitement et le Délégué à la protection des données (art. 57), ou encore l’analyse d’impact de protection des données (art. 62) ;
- sans oublier les autres Codes concernés par ces mesures, tels que le Code pénal sanctionnant « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » (art. 226-22-2 Code pén.)
Toutefois cet édifice juridique n’en est toujours pas à son terme dès lors que cette dernière Ordonnance n’entrera en vigueur qu’en même temps que le futur Décret devant modifier le Décret informatique et libertés du 20 octobre 2005... mais ce tout de même au plus tard le 1er juin 2019.
2. Délibérations et Modèles CNIL
Parallèlement aux Pouvoirs législatif et exécutif, l’Administration œuvre également, au niveau de la CNIL, pour aider les utilisateurs à appliquer le droit en vigueur.
En premier lieu la CNIL multiplie les notes « pratiques » et autres modèles accessibles sur son site Internet cnil.fr, dont notamment à souligner un registre type permettant à tout organisme de recenser au moins les données à caractère personnel dont il assure le traitement (fichiers clients, salariés, fournisseurs, etc...)
En second lieu la CNIL a également récemment défini, aux termes de deux Délibérations du 11 octobre 2018 (2018–326 et 2018–327), les types d’opérations de traitement suffisamment risqués pour qu’une « analyse d’impact » soit requise (à savoir essentiellement en matière de santé, ressources humaines, localisation ou encore logements sociaux).
Néanmoins sur ce point non plus la CNIL n’a pas « dit son dernier mot », dès lors qu’elle doit encore prochainement publier une liste des traitements qui, à l’inverse, ne présentant pas de risque élevé, ne sont donc pas soumis à la réalisation d’une telle analyse d’impact.
***
Rendez-vous est donc d’ores et déjà pris en 2019 pour surveiller ces nouvelles dispositions à venir tant sur le plan réglementaire qu’administratif.
Julie Gringore
Le défaut de souscription d’un contrat de prévoyance par un club professionnel de Basket-Ball : une faute qui coûte cher.
La responsabilité d’un club professionnel de Basket-Ball est encourue dès lors qu’il n’a pas souscrit le contrat de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective. Le contrat de travail du joueur est par ailleurs requalifié en CDI dès lors qu’il ne lui a pas été transmis dans les 48h suivant l’embauche.
En matière sportive la santé du joueur salarié est mise à rude épreuve. Il s’agit donc de lui accorder une protection toute particulière dès lors que la performance physique est l’outil de travail principal du salarié.
Plusieurs conventions collectives et accord sectoriels dans la branche du sport, ont donc prévu la souscription obligatoire de contrats de prévoyance qui doivent notamment permettre l’indemnisation du joueur salarié qui se trouverait inapte à la pratique professionnelle de son sport.
C’est le cas de la convention collective du basket professionnel.
Cette garantie est plus communément appelée la garantie « perte de licence », étant indiqué qu’elle n’empêche pas le sportif de souscrire, pour son propre compte, des garanties individuelles prévoyant des montants d’indemnisation supérieurs à ceux de l’accord collectif.
En l’espèce le club du Saint Quentin Basket-Ball qui évoluait alors en Pro B (deuxième division) n’avait pas souscrit un tel contrat.
Or l’un de ses joueurs salariés, victime d’un accident du travail, n’a pu reprendre son activité de joueur professionnel.
Il n’a donc pu bénéficier de la garantie « perte de licence », et a par conséquent saisi le Conseil de Prud’hommes pour solliciter l’indemnisation de son préjudice du chef de la faute commise par son employeur qui n’avait pas respecté l’obligation de souscription du contrat de prévoyance prévue par la convention collective.
Le joueur sollicitait également la requalification de son CDD en CDI, faute pour l’employeur de lui avoir transmis son contrat de travail dans les deux jours suivant son embauche.
Par une décision pour le moins étrange et juridiquement critiquable du 20 février 2017, le Conseil de Prud’hommes de Saint Quentin a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, le condamnant même à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 1.000 euros à titre d’amende civile.
Le salarié a interjeté appel du jugement.
Dans un arrêt du 14 novembre 2018, la Cour d’Appel d’Amiens a infirmé le jugement de première instance et a fait droit aux prétentions de l’appelant.
La Cour retient que le club a bien commis un manquement à ses obligations en s’abstenant de souscrire le contrat de prévoyance objet du litige.
Contrairement à ce que prétendait le club, la Cour retient que l’inaptitude n’a pas à être nécessairement constatée par le médecin du travail s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance, et que le joueur rapportait bien la preuve de celle-ci par divers avis médicaux.
Il est particulièrement heureux que la Cour n’ait pas suivi l’employeur dans cette argumentation étant donné que les joueurs professionnels sont souvent embauchés par le biais de CDD et que l’inaptitude peut parfois être constatée après le terme de ce CDD dans l’attente de la consolidation de son état de santé par suite d’un accident du travail. Or si le contrat de travail a pris fin, le joueur n’a plus accès à la médecine du travail.
Pour fixer le préjudice, la Cour de réfère à la convention collective applicable qui fixe un montant d’indemnités minimum que le contrat de prévoyance doit garantir en cas de perte de licence.
Il est intéressant de noter qu’au-delà des sportifs salariés, les Fédérations Sportives doivent également protéger la santé de leurs sportifs de haut niveau en souscrivant de tels contrats d’assurance (L321-4-1 du Code du Sport dont le décret d’application n°2018-851 a été publié le 4 octobre 2018, avec cependant des niveaux d’indemnisations bien moins élevés que les accords collectifs existant pour les sportifs salariés).
Enfin, la Cour a requalifié le CDD du joueur en CDI pour défaut de transmission dans les deux jours suivant l’embauche.
Le club soutenait qu’un projet de contrat de travail avait été transmis à l’agent sportif ayant servi d’intermédiaire entre les deux parties avant l’embauche.
Or en réalité l’agent sportif avait été mandaté par le club. Dès lors la Cour en conclut logiquement que la transmission du contrat d’un mandataire à son mandant ne peut valoir transmission au salarié.
On rappellera que l’agent sportif ne peut être mandaté que par une des deux parties à la signature du contrat de travail (article L 222-17 du Code du Sport).
Au total, c’est plus de 170.000 euros que le Saint Quentin Basket-Ball devra verser au joueur.
CA Amiens 14 novembre 2018 n°17/00956
L’Equipe Droit du Sport
Derby Avocats
Marque figurative : de couleur, de forme, de position… (CA Paris 15 mai 2018, n°15/11131)
Les possibilités de dépôts de marques prévues par le titre VII du Code de la propriété intellectuelle (CPI) sont multiples, allant de la simple marque verbale à la marque figurative, en passant par la marque semi-figurative ou encore la marque spécifiquement sonore...
Un récent arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 mai 2018 (15/11131) est l’occasion de rappeler les principales conditions de validité d’une marque figurative, en l’espèce constituée par l’apposition de la couleur rouge (avec un code Pantone précis) sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon haut, telle qu’exploitée par la Société Louboutin, mais remise en cause à titre reconventionnel par une société concurrente assignée en contrefaçon.
En premier lieu la marque doit pouvoir être concrètement identifiable et ne pas se limiter à une simple idée ; la frontière en la matière est souvent ténue, comme en l’espèce où la défenderesse invoquait l’article L. 711-1 du CPI en estimant que le dépôt n’était pas suffisamment précis pour que la marque concernée soit valable (simple idée de colorer une semelle en rouge selon elle), raisonnement qui n’a toutefois pas été suivi par la Cour d’appel (relevant au contraire « la clarté, la précision, l’intelligibilité, l’objectivité, la stabilité de la représentation graphique considérée »).
En second lieu, et plus classiquement, c’est le caractère distinctif de la marque que le défendeur a tenté de remettre en cause sur le fondement de l’article suivant L. 711-2 du CPI, en estimant que cette apposition de couleur rouge avait une valeur fonctionnelle pour les produits concernés et était donc potentiellement nécessaire pour les autres acteurs du marché, argument qui n’a toutefois pas non plus été retenu par la Cour, « d’autres choix étant tout aussi possibles » selon cette dernière.
***
Cette décision permet donc de rappeler, en synthèse, que le dépôt d’une marque figurative est possible sous de nombreuses formes à condition d’être suffisamment précis en sa représentation d’une part, et suffisamment distinct du produit lui-même d’autre part.
Julie Gringore
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2018/INPIM20180214
INDEMNITES DE TRANSFERT DES SPORTIFS PROFESSIONNELS ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE
Deux arrêts récemment rendus par la Cour d’Appel d’ANGERS le 12 juillet 2018, statuant sur renvoi de cassation, éclairent le traitement qu’il convient de faire des indemnités de transfert des sportifs professionnels dans le cadre d’éventuelles difficultés économiques de leurs employeurs.
Ces décisions apportent également des précisions quant aux conséquences d’une potentielle baisse des droits télévisés en matière de licenciement économique, et en ce qui concerne le périmètre d’appréciation des difficultés économiques et de l’obligation de reclassement dans les clubs sportifs professionnels.
***
Lors de l’intersaison 2012, le club de football FC LORIENT a procédé au licenciement économique de plusieurs salariés.
Les motifs invoqués tenaient aux difficultés économiques rencontrées par le club, notamment en raison d’une prévisible baisse des droits TV.
Par arrêt en date du 4 novembre 2015, la Cour d’Appel de RENNES estimait que les difficultés économiques étaient établies et les licenciements économiques bien fondés.
Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé les arrêts de la Cour d’Appel en lui reprochant d’avoir statué sur le fondement du licenciement en raison de difficultés économiques, alors que la lettre de licenciement invoquait des licenciements en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Les débats demeuraient donc ouverts devant la Cour d’Appel de renvoi quant au point de savoir si les éléments factuels débattus pouvaient justifier les licenciements économiques prononcés en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du club sportif.
***
Le premier argument soutenu par l’employeur tenait au fait que son « résultat d’exploitation » était depuis plusieurs années constamment déficitaire, ce qui établissait selon lui les difficultés économiques nécessitant la mise en place de mesures permettant de sauvegarder sa compétitivité, dont les licenciements économiques étaient l’aboutissement ultime.
Pour le club les indemnités de mutation liées au transfert de certains joueurs professionnels à la fin de chaque saison sportive étaient comptabilisées en « résultats exceptionnels » dans les comptes du club, ce qui établissait l’existence d’un déficit structurel, justifiant la mise en place des mesures de sauvegarde de compétitivité.
En synthèse le club soutenait qu’il ne pouvait pas, sans s’appauvrir, être contraint de vendre chaque année des joueurs pour équilibrer son budget.
La Cour d’Appel d’Angers ne suit pas ce raisonnement et estime au contraire que :« ces ventes ne constituaient pas un appauvrissement du club qui se séparait de ces joueurs en réalisant une plus-value, dont la valeur financière est intégrée par la DNCG dans les comptes de résultat des clubs professionnels qu’elle contrôle et, selon les bilans comptables dans le résultat net en tant que rentrée financière ».
Ainsi, le fait qu’une fois les transferts comptabilisés, le club dispose de résultats positifs, suffisait à établir l’absence de difficultés financières, et ce même si chaque année le montant des transferts opérés n’était pas certain.
Ce faisant la Cour d’Appel d’ANGERS s’aligne sur la position de la DNCG qui -dès lors que ces rentrées sont certaines et non hypothétiques- admet de manière constante que le fruit des opérations de mutation a vocation à être intégré dans les comptes, pour apprécier si l’équilibre budgétaire du club sportif est, ou non, atteint.
Admettre le contraire reviendrait d’ailleurs à permettre de manière constante aux clubs de procéder à des licenciements économiques fondés sur ce motif, puisque les rapports de la DNCG établissent que les clubs de football français sont structurellement déficitaires pour ce qui touche au résultat d’exploitation (moins 331 000 000 € en 2011/2012 et moins 383 000 000 € en 2015/2016) ; alors qu’à l’inverse les résultats des opérations de mutation sont positifs :(+ 180 000 000 € en 2011/2012 et + 429 000 000 € en 2015/2016).
On trouve d’ailleurs ici un alignement, en matière de droit du travail, sur la position récemment prise par le Conseil d’Etat à l’occasion d’un litige portant sur le point de savoir si les indemnités de cession des contrats de joueur participaient à l’activité normale et habituelle du club, ou au contraire revêtait un caractère accessoire, de sorte qu’elles n’avaient pas vocation à être prises en compte dans le calcul de la valeur rajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle.
Dans son arrêt du 6 décembre 2017 (n° 401533) le Conseil d’Etat a en effet retenu que ce type d’opération « présente un caractère récurrent et génère une part significative voire structurelle des produits financiers des clubs, fait partie du modèle économique de ces clubs et dès lors doit être regardé comme ayant un caractère habituel alors même que les transferts des joueurs n’interviendraient pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus grand profit ».
***
Par ailleurs les deux arrêts rendus apportent également une réponse intéressante quant à l’appréciation d’une baisse potentielle des droits télévisés dans le cadre d’éventuelles procédures de licenciement économique.
Même si à l’heure actuelle ces droits télévisuels apparaissent à la hausse dans le secteur du football, la Cour indique pour la première fois à notre connaissance que cette baisse potentielle des droits télévisuels n’a pas nécessairement pour effet immédiat une nécessité pour les clubs de sauvegarder leur compétitivité.
En effet, dès lors que cette baisse a vocation à toucher de la même manière l’ensemble des entreprises du secteur d’activité (en l’espèce celui du football professionnel) il pouvait être retenu qu’il ne s’en induisait pas une distorsion de compétitivité entre chacun des clubs.
La Cour estime en effet, outre le fait qu’il n’était pas possible pour l’employeur de présumer qu’il occuperait la saison suivante une place moins favorable à celle obtenue au jour des licenciements, que celui-ci ne prouvait pas davantage : « que la compétitivité des autres clubs du championnat de France de football professionnel s’en trouvait améliorée et menaçait la sienne ; aucune pièce n’étant produite de nature à démontrer que sa compétitivité est en péril vis-à-vis des autres clubs et sur le secteur d’activité de football professionnel français. »
***
Enfin l’arrêt confirme, pour ce qui touche au périmètre d’appréciation des difficultés économiques et de l’obligation de reclassement, que celui-ci comporte non seulement la société gérant les activités professionnelles du club, mais doit également s’apprécier au niveau du groupe intégrant les filiales, ainsi qu’en intégrant l’association support loi 1901 gérant le secteur amateur et le centre de formation, laquelle dispose de liens structurels avec le club professionnel (article R 122-8 du Code du sport). Déjà en ce sens (CA AIX 27.01.2015 RG 2015/71 MATTEI/OGC NICE)
Département Droit du port
DERBY AVOCATS
Entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données le 25 mai 2018 (Règlement CE 2016/679)
Le Règlement Général sur la Protection des Données (ci-après RGPD) réforme la gestion des données personnelles au niveau européen, faisant notamment passer la France :
• de son ancien système déclaratif en amont auprès de la Cnil,
• à un système de contrôle en aval par cette dernière, avec sanctions financières possibles (jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel).
Les collecteurs de données devront ainsi s'assurer de remplir les trois critères suivants :
• d'information préalable auprès des personnes dont les données sont collectées,
• de proportion entre ces données et leur utilisation,
• de protection de ces données contre tout accès illégal.
Une analyse doit être menée afin de vérifier que ces trois critères sont dûment remplis, et anticiper ainsi tout contrôle possible de la Cnil ; cette mission comprend notamment :
• la rédaction de la clause d'information correspondante pour les CGV ou tout autre document contractuel,
• la vérification de l'adéquation des données collectées avec l'activité concernée,
• un point avec le prestataire informatique intervenant afin de s'assurer que les mesures de sécurité nécessaires ont effectivement été mises en place.
Par ailleurs lorsque la collecte de données est régulière et systématique, ou lorsqu'elle porte à grande échelle sur des données sensibles (médicales, politiques, syndicales...), le collecteur de données doit désigner un délégué à la protection des données (ci-après DPO), étant précisé que :
• même lorsqu'elle n'est pas obligatoire, cette désignation est possible, voire conseillée, pour assurer la bonne gestion des données selon les trois critères susvisés,
• le DPO peut être désigné en interne ou pris en la personne d'un prestataire externe, tel un avocat.
***
Cette nouvelle réglementation RGPD est donc à la fois source de simplification (une déclaration Cnil n'étant plus préalablement obligatoire) et de responsabilisation (le collecteur de données devant lui-même assurer son « auto-contrôle », le cas échéant avec désignation d'un DPO) ; l'appliquer est en outre l'occasion pour les entreprises de communiquer sur leur conformité en la matière auprès de la clientèle concernée.
Le Cabinet Derby Avocats accompagne les sociétés dans cette adaptation, en proposant :
• des prestations d'analyse de l'existant et d'ajustement à la nouvelle réglementation en termes d'information, de proportion et de protection des données,
• une mission de DPO si nécessaire pour les entreprises préférant externaliser cette fonction.
Julie Gringore
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Indemnisation en cas de contrefaçon : les options pour la victime (Crim. 27 fév. 2018, n° 16-86881)
Deux principales options s'offrent à la victime de contrefaçon pour agir en justice d'une part, et voir son préjudice indemnisé d'autre part, sur le fondement du Code de la Propriété Intellectuelle (en matière de marques, dessins et modèles, brevets, et droits d'auteur notamment).
En premier lieu, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut faire le choix d'une action civile ou d'une action pénale, lesquelles présentent respectivement les principaux avantages suivants :
- l'action civile, plus usuellement engagée entre concurrents, présente l'avantage d'être traitée par quelques Tribunaux de Grande Instance très spécialisés (uniquement le TGI de Paris pour les brevets, outre 8 autres TGI également pour les marques, dessins et modèles, et droits d'auteur) ; les condamnations pécuniaires peuvent y être plus importantes qu'au pénal, et les délais de traitement (relativement) plus courts ;
- l'action pénale, plus usuellement utilisée contre les réseaux « délinquants », présente l'avantage dissuasif des sanctions pénales (outre l'indemnisation de la victime), et la possibilité de s'appuyer sur les pouvoirs d'investigation publics.
Statistiquement l'action civile demeure plus utilisée par les titulaires de droits de propriété intellectuelle, seuls environ 25 % du contentieux de contrefaçon étant engagés au pénal ; la présente décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 février 2018 en est un intéressant exemple en matière de droit pénal d'auteur.
En second lieu depuis la Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007, les victimes des actes de contrefaçon ont le choix, pour évaluer le montant du préjudice subi, entre :
- soit tenir compte d'un ensemble de données chiffrées, mais qu'il n'est pas toujours aisé de réunir, telles que :
« 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits » ;
- soit, à titre d'alternative, déterminer une somme forfaitaire, qui sera « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte », étant précisé que « cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
L'arrêt susvisé du 27 février 2018 présente l'intérêt de rappeler que cette seconde option « forfaitaire » ne peut être mise en œuvre qu'à la demande de la victime, et non pas à la seule initiative de la juridiction ; ainsi la Cour d'appel qui « n’était pas saisie par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire... n’a pas justifié sa décision » sur ce point, selon la Cour de cassation.
***
Les titulaires de droits de propriété intellectuelle disposent donc stratégiquement de nombreuses options en fonction des éléments factuels et économiques de leurs dossiers, et demeurent ainsi seuls « maîtres » de leur mise en œuvre, sans que les juridictions ne puissent leur imposer ni une voix particulière d'action en amont (civile ou pénale), ni un mode indemnitaire déterminé en aval (comptable ou forfaitaire).
Julie Gringore
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036697003&fastReqId=1980900064&fastPos=1
La procédure d’auto-saisine de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage sanctionnée par le Conseil Constitutionnel.
Le 2 février 2018, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision attendue.
Le 6 novembre 2017, le Conseil d’Etat avait transmis au Conseil Constitutionnel un Question Prioritaire de Constitutionnalité dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution de 1958, visant à savoir si les prérogatives de l'AFLD lui permettant de se saisir d'office d'une décision fédérale en matière de lutte anti-dopage qu'elle envisage de réformer et de statuer ensuite sur le cas dont elle s'était auto-saisie est conforme au principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement.
En effet, il convient de rappeler que le principe qu’il découle de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Hommes et du Citoyen un principe d’indépendance et d’impartialité qui doit guider le rendu de la justice.
L’Agence Française de Lutte contre le Dopage, en tant qu’autorité administrative indépendante disposant d’un pouvoir disciplinaire qui peut la conduire à suspendre un sportif et le condamner pécuniairement, est soumise à ce principe.
Après avoir rappelé que l’article L.232-22 du Code du Sport permet à l’AFLD « réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21 [décision disciplinaire prise par une Fédération sportive]. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées », le Conseil juge la faculté de cette autorité administrative de s’auto-saisir d’un dossier et de le juger ensuite contrevient au principe constitutionnel précitée.
Cependant, pour éviter des conséquences qu’il estime excessive, le Conseil Constitutionnel repousse au 1er septembre 2018 les effets de cette inconstitutionnalité, permettant ainsi au législateur de faire évoluer la législation et les procédures de saisine de l’AFLD pour les rendre conforme à la Constitution.
Il convient désormais de s’interroger sur les effets d’une telle décision sur les dispositions règlementaires des Fédérations qui permettent souvent à ses instances dirigeantes de solliciter une enquête et un contrôle anti-dopage, alors même que cette même Fédération aura ensuite la charge d’instruire puis de juger les résultats dudit contrôle.
Le lien vers la décision :
L’Equipe Droit du Sport
Derby Avocats